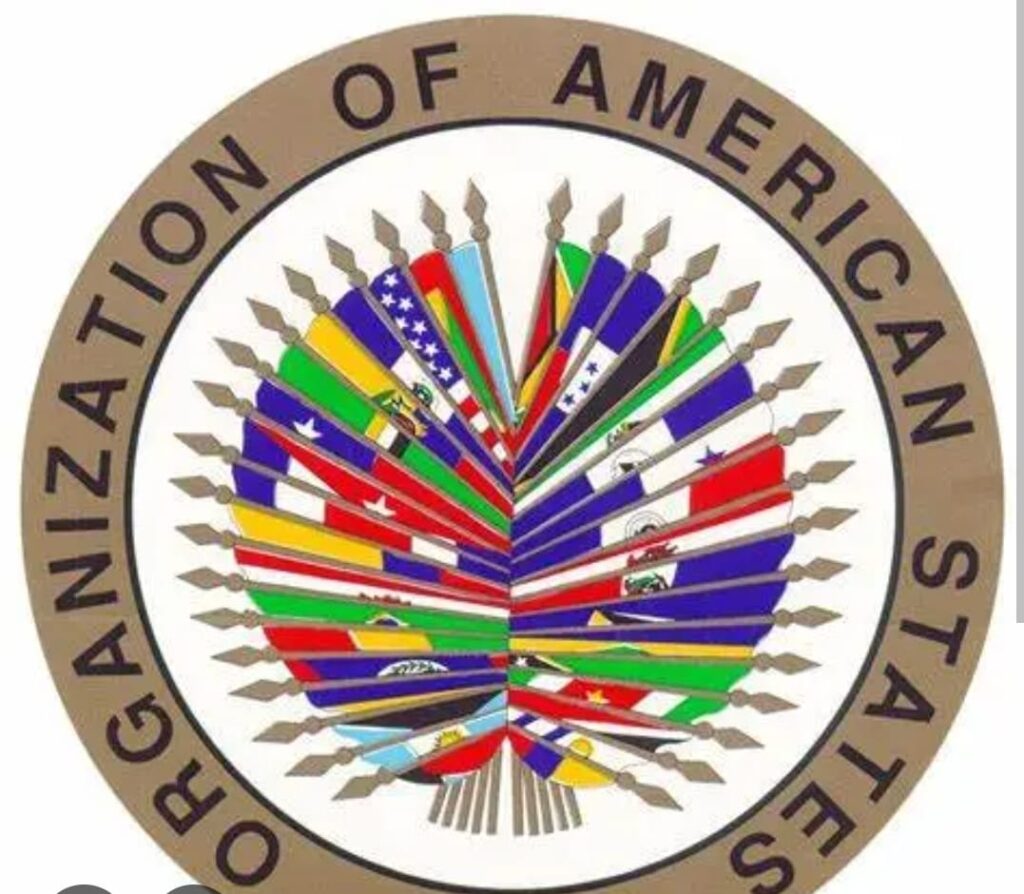Face à l’effondrement sécuritaire et institutionnel d’Haïti, l’Organisation des États américains adopte une résolution d’urgence lors de sa 55e session à Antigua-et-Barbuda. Message clair aux 34 pays membres : il faut agir maintenant avant qu’il ne soit trop tard.
Les mots n’ont jamais été aussi forts. Du 25 au 28 juin 2025, à Antigua-et-Barbuda, l’Organisation des États américains (OEA) a adopté une résolution qui sonne comme un cri d’alarme pour Haïti. « Instabilité généralisée », « effondrement complet » : le vocabulaire utilisé par les diplomates reflète la gravité d’une situation qui dépasse désormais les frontières haïtiennes.
Les gangs dictent leur loi, l’État s’effrite
La réalité est brutale : les gangs armés contrôlent aujourd’hui une part significative du territoire haïtien. De Port-au-Prince aux provinces, ces groupes imposent leur loi « en toute impunité », selon les termes de la résolution. Une situation qui rappelle douloureusement aux Haïtiens de la diaspora les images qui défilent quotidiennement sur leurs écrans, montrant un pays méconnaissable.
Ce qui inquiète particulièrement l’OEA, c’est l’impact sur la jeunesse haïtienne. L’organisation déplore le recrutement forcé d’adolescents dans les gangs, souvent faute d’alternatives scolaires ou professionnelles. Un cercle vicieux qui prive le pays de ses forces vives et alimente une violence sans fin.
Les femmes et les filles paient également un prix très lourd. L’OEA tire la sonnette d’alarme sur la montée « alarmante » des violences sexuelles, appelant à des réponses centrées sur les victimes et la prévention.
Un plan d’action dans 45 jours
Face à cette urgence, l’OEA ne se contente pas de constats. Elle exige des actions concrètes. Le Secrétariat général a 45 jours pour élaborer un plan d’action global en concertation avec le gouvernement haïtien, le BINUH (Bureau intégré des Nations Unies en Haïti) et la Mission multinationale d’appui à la sécurité (MMAS).
L’organisation pousse aussi les États membres à renforcer leur soutien à la MMAS, cette mission dirigée par le Kenya qui peine encore à déployer ses pleins effectifs sur le terrain. Pour beaucoup d’Haïtiens, cette mission représente un espoir fragile de voir enfin la paix revenir.
S’attaquer aux racines du mal
Mais l’OEA va plus loin. Elle insiste sur la nécessité de traiter les causes profondes de la crise : pauvreté extrême, corruption endémique, inégalités structurelles, effondrement du système judiciaire. Des maux que connaissent bien les Haïtiens, qu’ils vivent à Port-au-Prince, aux Gonaïves ou dans la diaspora de Miami, Montréal ou Paris.
L’organisation appelle notamment à appliquer les recommandations du mécanisme anti-corruption (MESICIC) et à renforcer les contrôles douaniers pour limiter l’approvisionnement des gangs en armes illégales.
Une conférence internationale en vue
L’OEA projette également d’organiser une conférence internationale de bailleurs de fonds pour coordonner l’aide financière et logistique. Une initiative qui pourrait mobiliser non seulement les gouvernements, mais aussi la puissante diaspora haïtienne, toujours prête à soutenir son pays d’origine.
L’organisation veut aussi intensifier le dialogue avec le Conseil de sécurité de l’ONU pour explorer toutes les pistes possibles de renforcement de l’aide sécuritaire.
La communauté régionale ne tournera pas le dos à Haïti, promet l’OEA. Mais au-delà des déclarations, les Haïtiens attendent des actes concrets. Car comme l’a souligné un haut responsable de l’organisation : « C’est une responsabilité morale et historique. » Une responsabilité que porte aujourd’hui toute la région des Amériques face à la détresse d’un peuple qui refuse de baisser les bras.