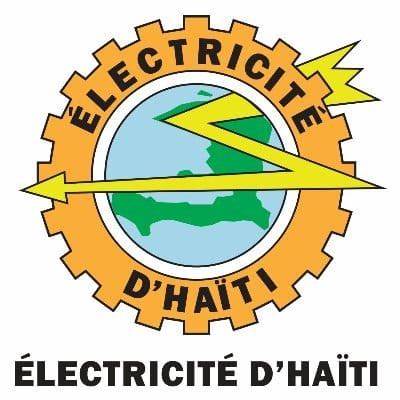Depuis juin, plusieurs quartiers de la capitale haïtienne sont privés d’électricité suite au sabotage de pylônes à Péligre. Hôpitaux en détresse, économie paralysée : quand l’EDH retrouvera-t-elle sa capacité à éclairer le pays ?
Un mois de juin qui restera dans les annales comme celui de la grande panne. Depuis plusieurs semaines, de nombreux quartiers de Port-au-Prince vivent au rythme des bougies et des lampes de poche, replongeant la capitale dans une époque que beaucoup croyaient révolue. Une situation qui rappelle cruellement aux Haïtiens, tant ceux du pays que de la diaspora, la fragilité chronique du système électrique national.
Péligre au cœur de la crise
L’origine de cette crise ? La centrale hydroélectrique de Péligre, poumon énergétique du pays, contrainte à l’arrêt par des habitants de Mirebalais protestant contre l’insécurité qui règne dans leur commune. Un cercle vicieux typiquement haïtien : l’insécurité qui génère des protestations, lesquelles créent à leur tour de nouveaux problèmes pour l’ensemble du pays.
Selon l’EDH, cinq pylônes ont été sabotés, nécessitant « des réparations majeures et une mobilisation logistique de grande envergure ». Une situation qui démontre une fois de plus la vulnérabilité d’un système électrique déjà fragile, où quelques infrastructures endommagées peuvent plonger des centaines de milliers de personnes dans l’obscurité.
Les hôpitaux en première ligne de la souffrance
Les conséquences de cette panne dépassent largement les désagréments domestiques. À l’Hôpital Universitaire de La Paix, le directeur exécutif Paul Junior Fontilus a lancé un véritable cri d’alarme. L’institution consomme plus de 400 gallons de carburant par jour pour faire fonctionner ses générateurs, soit une facture quotidienne de plus de 600 000 gourdes.
« Si aucune décision n’est prise pour rétablir l’électricité à Port-au-Prince, il nous sera difficile de tenir », avait-il alerté. Une déclaration qui résonne comme un appel au secours dans un pays où l’accès aux soins de santé relève déjà du parcours du combattant.
L’EDH face à ses responsabilités
Dans une note publiée ce vendredi 4 juillet, l’EDH a tenté de rassurer ses abonnés, promettant de « travailler sans relâche pour permettre le retour normal de l’électricité dans les meilleurs délais ». L’institution publique mise désormais sur ses centrales thermiques pour pallier l’arrêt de Péligre, une solution coûteuse et polluante en pleine saison pluvieuse.
« L’Électricité d’Haïti travaille d’arrache-pied en vue d’un retour à la normale dans les meilleurs délais », promet le bureau de communication, appelant la population « au calme, à la retenue, à la compréhension et à la patience ».
Un appel à la patience qui a ses limites
Cette demande de patience de la part de l’EDH intervient dans un contexte où les Haïtiens font déjà preuve d’une résilience extraordinaire face aux défaillances chroniques des services publics. Pour les familles qui dépendent de l’électricité pour leurs petits commerces, pour les étudiants qui tentent d’étudier dans l’obscurité, pour les malades qui ont besoin de soins médicalisés, cette « patience » a un coût humain considérable.
La situation rappelle les grandes pannes du passé qui ont marqué l’histoire récente du pays, notamment celle de 2018 qui avait paralysé la capitale pendant des semaines. Pour les Haïtiens de la diaspora qui suivent l’évolution de leur pays natal, ces épisodes récurrents illustrent la persistance des défis infrastructurels majeurs.
Au-delà de la technique, une question de gouvernance
Cette crise électrique soulève des questions fondamentales sur la capacité de l’État haïtien à protéger ses infrastructures stratégiques et à garantir les services essentiels à sa population. Comment des pylônes électriques peuvent-ils être sabotés aussi facilement ? Comment l’insécurité dans une commune peut-elle paralyser toute une région métropolitaine ?
Alors que l’EDH multiplie les promesses de rétablissement, une question demeure : combien de temps encore les Haïtiens devront-ils vivre dans l’incertitude énergétique ? La lumière reviendra-t-elle vraiment dans les « meilleurs délais » promis, ou faudra-t-il encore s’armer de patience dans un pays où l’électricité reste un luxe plutôt qu’un droit ?